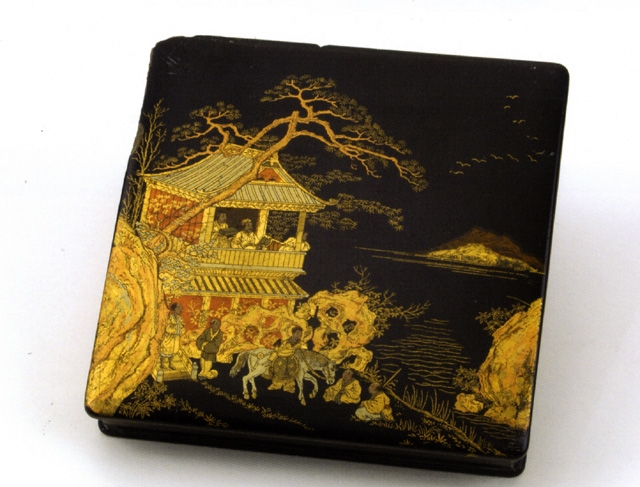parent nodes: Dictionnaire du département de la Moselle
Adt
Communication de Monsieur Pierre LALLEMAND
Le Papier Mâché en Lorraine
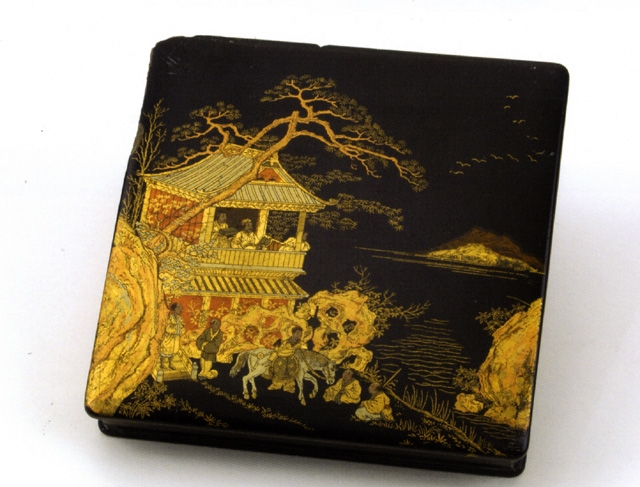
Le terme consacré de papier mâché est peu flatteur, cependant l’ancienneté
de sa fabrication, sa décoration, son entrée plus récente au Musée
de Pont-à-Mousson lui ont conféré les titres de noblesse qui, jusqu’alors,
lui faisaient défaut.
L’engouement dont le papier mâché a été l’objet au XIXème siècle, particulièrement
sous le règne de Victoria en Angleterre et sous celui de Napoléon III
en France est à l’origine de sa diffusion en Occident. Il apportait alors une
note d’exotisme venue d’Extrême-Orient, si prisée dans l’art nouveau.
Fabriqué en Angleterre dans les Midlands par Henry Clay et
Baskerville à la fin du XVIIIème siècle, il y avait été introduit par des
travailleurs français émigrés à Londres. C’est en effet à partir de 1690
que les Huguenots ont fabriqué la pâte à papier appelée “ Chewed Paper ”
connue des Chinois dès le deuxième siècle après J.C.
Ce sont d’ailleurs des artisans chinois, envoyés à Samarkand, qui ont
transmis la fabrication du papier mâché aux Perses, de là aux Arabes.
C’est donc de l’Orient, à travers Venise que les Italiens l’ont reçue. Ils
l’appelaient la “ carta pasta ” et en faisaient des objets à partir de feuilles
de papier collées l’une sur l’autre.
La France se spécialisa d’abord dans les tabatières ; médicament universel,
le tabac était prescrit sous forme de poudre par les médecins pour
combattre les maux de tête. La mode en était venue de la cour sous le
règne de Charles IX (1560-1574). L’habitude de “ prises ” se répandit
dans les milieux de l’aristocratie, puis de la bourgeoisie et du peuple.
Un relieur de Paris nommé Martin, fabriqua les premières tabatières
en papier mâché pour remplacer celles qui furent d’abord l’apanage des
bijoutiers et des orfèvres.
L’industrie des tabatières se répandit alors rapidement et les Français
exportèrent en Allemagne les premières boîtes en papier mâché.
En Russie, la fabrication des tabatières –en papier mâché- se développe
vers 1830 dans le village de Fedoskino à 20 km au nord de Moscou
par des artisans paysans et sa diffusion se fit rapidement sur tout le
territoire russe. Cet épanouissement des objets laqués et décorés est lié
aux noms des Korobov puis à leurs successeurs les Loukoutine. C’est
entre 1825 et 1835 que les Loukoutine passèrent au stade industriel
pour arriver vers 1870 à une production de masse.
Fedoskino, Palekh, Mstiora et Kholouï sont actuellement les quatre
centres de la peinture sur laque en Russie.
Le Japon connaissait depuis longtemps l’art du laque ; on fabriquait
de la vaisselle, des récipients, des plateaux à partir du papier que l’on
faisait bouillir, d’où le nom également employé de “ carton bouilli ”.
L’intérêt pour la laque réveilla l’attention des Anglais. En 1758, un
Anglais n’écrivait-il pas que la véritable laque avait été d’abord utilisée
pour vernir les boîtes à tabac ?
Le papier mâché gagna également l’Amérique. G. Washington avait
lui-même acheté du papier mâché pour orner deux de ses pièces au Mont
Vernon. Au milieu du XIXe siècle, il y avait quatre petites usines de
papier mâché dans le nord-ouest du Connecticut dont la plus importante
était la Lichtfield Manufactury Company fondée en 1849. Ses
directeurs avaient fait venir des laqueurs d’Angleterre pour diriger le
travail et enseigner l’art du laquage.
A cette époque, l’essor du papier mâché prit de l’importance, lié à un
engouement qui ne cessa de croître pour atteindre son apogée à la fin du
XIXème siècle et au début du XXème siècle. En France et en Lorraine, les
frères Adt possédaient alors le quasi-monopole de sa fabrication.
Les Adt
L’histoire de la famille Adt est d’abord liée à celle de la tabatière. On
fabriquait à Sarreguemines et dans les campagnes de la Moselle pas moins
de deux millions de tabatières dont le tiers était exporté.
Un article du “ Magasin Pittoresque ” de 1852 précise “ qu’il était impossible
de contester à la France une véritable supériorité dans cette fabrication
”. Et il ajoute : “ les tabatières de Sarreguemines attestent l’intelligence,
le goût et l’habileté des fabricants, elles sont remarquables par la correction du
travail, la délicatesse et l’élégance des incrustations en nacre, en étain ou en
argenton (alliage de cuivre et de nickel), la netteté du vernis ”.
Elles étaient vendues sur les foires ou par des colporteurs et trouvaient
leurs débouchés jusqu’en Italie et en Allemagne.
Cependant, après le régime napoléonien et la crise due à la concurrence
de la tabatière de Nuremberg, colportée par les Juifs et vendue à
très bas prix, cette industrie à domicile qui occupait près de 250 familles
dans les environs de Sarreguemines, recula.
Une seule entreprise résista : celle des frères Adt. Elle employait, en
1850, 300 ouvriers. En dehors d’Ensheim, les Adt fondèrent deux autres
fabriques à Forbach et à Pont-à-Mousson. Ces trois entreprises occupaient,
en 1889, année du 50ème anniversaire de leur existence, 2500
ouvriers.
Les Adt étaient venus de Suisse, parmi tant d’autres familles, pour
repeupler le Palatinat dévasté par la guerre de Trente Ans.
Les premières mentions dans les archives se trouvent à la frontière
entre la France et l’Allemagne, à Frauenberg-sur-la-Blies, petit village
proche de Sarreguemines. Elles concernent Johannes Adt, meunier de
son état et l’un de ses fils, Mathias, baptisé le 23 janvier 1715 à Ensheim.
Mathias Adt est considéré comme le fondateur d’une dynastie qui, partie
modestement, parvint au sommet des magnats de l’industrie à la fin
du XIXème siècle. Pendant ses loisirs, le garçon meunier fabriquait des
tabatières, les “ Mullerdosen ” pour les chanoines prémontrés de
Wadgassen. Ceux-ci les revendaient sous le nom de “ Klosterdosen ”
(boîtes du couvent).
Michael Stein, abbé des prémontrés de Wadgasse de 1743 à 1778,
sous l’abbatiat duquel fut signé le traité d’échanges en 1766 entre la
couronne de France et la principauté de Nassau-Sarrebrück, ramène de
Paris les tabatières en papier mâché du relieur Martin. Les imitations
qu’en fit Mathias Adt sur les ordres du Père Abbé connurent la réussite
et devinrent rapidement un facteur économique important de la localité
d’Ensheim.
La Révolution et l’Empire furent favorables à la famille Adt. Il appartint
à l’un des petits-fils de Mathias, Pierre Adt, né en 1798, de faire
passer la production des tabatières du stade artisanal au stade industriel.
Déjà, au milieu des années trente du XIXème siècle, il concourait sur les
foires expositions, à Munich en 1835 où il obtenait une médaille d’argent,
à Spire en 1837, une médaille d’or.
Entre-temps, Pierre (que l’on appellera Pierre III) créait, avec ses trois
fils, Pierre IV, Franz et Johann-Baptist, la firme de “ Gebrüder Adt ”. Il
installait en 1853, une usine à Forbach pour éviter les droits de douane
avec la France.
L’évolution de nouvelles machines, la recherche de nouveaux brevets,
de nouveaux modèles, amenèrent les Adt à être une des entreprises les
plus puissantes de Lorraine et à occuper dans leur branche, la fabrication
des objets laqués (ils n’ont jamais utilisé le terme de papier mâché,
mais celui de «carton laqué») le premier rang mondial.
Dès 1888, ils installaient des filiales, s’appuyant sur l’organisation de
la maison Villeroy et Boch, à Berlin, Nuremberg, Milan, Londres, Bruxelles.
Seuls mécomptes la filiale de New York, fondée en 1888, mais touchée
par la loi Mac Kinley (taxes à l’importation).
Pierre Adt IV, né en 1820, avait fait ses études en France, en 1865,
il devint maire de Forbach. La guerre de 1870 entraîna de sérieuses
modifications dans la structure de la firme et dans la vie même de
son directeur. Pour sauver le marché français, Pierre Adt démissionna
de son poste de maire, opta pour la France et fonda l’usine de Pont-
à-Mousson qu’il installa dans une partie des locaux de l’ancienne
université.
En 1880, il était fait Chevalier de la Légion d’Honneur par décret du
23 octobre, distinction qu’il reçut des mains du Président de la République
Sadi Carnot.
Au début du XXème siècle, la famille Adt contrôlait trois groupes d’usines :
-le groupe palatin dirigé par Edouard Adt qui se composait de l’usinemère
d’Ensheim, de la papeterie cartonnerie de Schwarzenacker et
de la centrale de Blies-Schwegen en Lorraine,
- le groupe de Forbach comprenant l’usine de Forbach, la papeteriecartonnerie
de Marienau, sous la direction de Jean-Baptiste Adt et
de son fils Gustave,
- le groupe français constitué par l’usine de Pont-à-Mousson et la
cartonnerie-papeterie de Blénod fondée en 1872 sous la direction
d’Emile Adt, fils de Pierre IV. Pierre Adt était également le
président fondateur de la tuilerie de Jeandelaincourt créée le 16
septembre 1893.
A la mort de Pierre Adt, le 10 avril 1900, les établissements Adt
passèrent à ses deux fils Henri, le “ Magnifique Adt ” (suivant le mot du
Cardinal Mathieu) et Emile “ l’ADT E athée ”.
L’usine de Pont-à-Mousson comptait alors 800 “ ouvriers en laque ”
dont 300 femmes et 70 enfants travaillant 11 heures par jour. Il y avait
en outre de nombreux dessinateurs, véritables artistes et spécialistes qui
possédaient une profonde connaissance de leur métier.
Les Adt ont exposé sans discontinuité à Leipzig de 1835 à 1939. On
les trouve également à Mayence, Munich, Strasbourg et dans les grandes
expositions universelles de Berlin, Bruxelles, Anvers, Londres, Melbourne.
A Paris, ils reçurent la médaille d’or en 1889 et en 1900 le grand Prix
avec deux médailles d’argent. L’extrême variété de la production comprenait
dès 1889, d’après les catalogues illustrés et édités en trois langues
par la firme plus de 10.000 articles divers.
La concurrence était faible, les concurrents les plus sérieux étant les
Anglais.
On lit dans la “ Hotte du chiffonnier ”, ouvrage de Louis Paulian publié
en 1885 : “ MM. Adt frères qui possèdent à Pont-à-Mousson et à Forbach
deux usines modèles dans lesquelles ils occupent 1.800 ouvriers, fabriquent
cinq millions de boutons par jour… Le carton pâte ne sert pas seulement
à fabriquer des boutons de bottines et de pantalons, on l’emploie encore pour
faire de l’article laqué : plateaux, tabatières, guéridons et mille objets qui se
vendent couramment sous le nom d’articles du Japon. Avec le carton pâte,
MM. Adt font des panneaux décoratifs d’appartement d’un goût exquis….
Depuis quelques années, MM. Adt font avec ce carton des roues de chemin
de fer (en Allemagne) ; la compagnie des chemins de fer de l’Etat étudie
l’emploi des roues de carton. Si cette industrie continue à progresser comme
elle l’a fait depuis quelques années, avant peu un grand nombre de nos
meubles seront fabriqués avec du carton pâte,… ”
La guerre de 1914 fit perdre aux Adt la majorité de leur patrimoine.
Les Adt de Forbach furent expulsés par l’autorité française et virent leurs
biens mis sous séquestre. Les usines ne retrouvèrent jamais leur ancienne
prospérité, ni leur importance.
En 1927, Forbach et Pont-à-Mousson furent rachetées par un groupe
de financiers français rassemblés dans une société anonyme la S.U.T.E.
(Société d’usinage de tubes électriques) (Adt, Thomson, Jeumont-Schneider
et la Compagnie Générale d’Electricité).
Dès 1960, la fermeture de l’usine de Forbach fut décidée et la production
ramenée à Pont-à-Mousson. Pierre Jacquemin, P.D.G. des Etablissements
Adt racheta en 1961 la cartonnerie de Blénod. Avec son
épouse France Vialanez, ils ont fondé, en 1989, la nouvelle société A.C.T.
(Ateliers de chaudronnerie thermoplastique). Celle-ci fabrique
aujourd’hui, avec de nouvelles matières, des produits haut de gamme :
plateaux de service en résine de polyester, tables gigognes, porte-revues
aux décors recherchés, sur les anciennes machines qui fabriquaient autrefois
le papier mâché.
La fabrication des cartons laqués
Elle ne différait pas en application de celle des entreprises similaires.
Les matières premières, carton et papier, étaient stockées dans les
cartonneries papeteries fondées par les Adt.
Le rapport Grandeau en date du 30 juillet 1876, nous renseigne sur
la succession des différentes opérations qui conduisaient, à l’époque, à la
transformation de 4.500 quintaux de carton en feuilles.
La pâte obtenue était imprégnée d’huile de lin jusqu’à saturation et
séchée dans des étuves souterraines puis “ cuite ”. Cette cuisson des laques
était un élément de fabrication indispensable et le travail ne pouvait être
exécuté que par un seul homme détenant tous les secrets de fabrication.
Dans la production des boîtes ou autres articles, seules quelques phases
de travail étaient assurées par la machine. Le produit fabriqué nécessitant
un travail manuel parfait. Le laquage était une opération longue
et délicate, la matière de base était la sève d’un arbre d’Extrême-Orient,
le rhus vernicifera de la famille des térébinthacées, utilisé au Japon. L’emploi
de cette laque était difficile en raison d’une technique compliquée
et d’une mauvaise réaction à la chaleur sèche. Elle durcissait en quatre
heures dans une atmosphère humide (80% d’humidité relative à une
température de 30 à 40° Celsius).
Elle renfermait en outre un poison virulent propre à cette espèce de
sumac qui pouvait causer une dermatite profonde. Je précise que le terme
de laque est couramment donné à des vernis ; il est féminin quand il
désigne la matière brute, masculin quand il s’agit de l’objet décoré.
Les opérations de laquage étaient longues, elles étaient suivies après
chaque couche du polissage effectué avec schiste d’un grain très fin.
On ne donnait jamais moins de trois couches, ni plus de dix-huit.
Le soin d’orner de dessins cette surface polie était confié à des artistes
qui apposaient leurs esquisses à l’aide d’un poncif. La décoration était
faite d’or, d’étain, de feuilles d’argent, de nacre, d’écaille de tortue, de
corne de buffle.
La nacre était utilisée de longue tradition : c’était la “ porcelaine de
mollusque ” importée de Chine, de Ceylan, du Golfe Persique. La plus
grande demande était celle de la nacre blanche, tirée de la perle
margatifera ; d’autres types étaient connus pour leurs couleurs irisées à
contours jaunes, rouges et verts : les abalones et le burgau. La firme Adt
envoyait en Extrême-Orient des artistes afin de relever des croquis pour
servir de modèles aux décors de leurs objets laqués.
Ces objets s’adressaient à un large public : leur gamme était d’une
étonnante variété ; ils allaient des articles publicitaires les plus simples
aux meubles, panneaux de décoration, commodes, sièges en passant par
les plus courants.
Les catalogues offraient 1.100 sortes de tabatières, les écoliers avaient
le choix entre 180 variétés de plumiers. L’art de la table comprenait les
articles les plus divers : plateaux, rafraîchissoirs à vin, ramasse-miettes,
corbeilles à pain, dessous de plats, de carafes, des verres, au total plus de
650 articles de table et 300 sortes d’assiettes.
L’industrie avait à sa disposition 330 articles de bureau. Les garnitures
pour le mobilier étaient les plus recherchées.
Les catalogues édités entre les deux guerres ne présentaient plus que
des articles courants : jouets, poupées, chevaux sur roulettes, plateaux
publicitaires, etc…
On fabriqua même des douilles de cartouches, des boucliers de C.R.S.,
des baraquements militaires. Tous ces articles en carton laqué s’étaient
multipliés rapidement. Partis de la tabatière, ils s’étaient diversifiés et
adaptés au XIXème siècle à une société de consommation friande de petits
meubles, guéridons, tables basculantes, coiffeuses, éventails, pare-
joues, bonheurs du jour, “ compagnons de dames ” et tous éléments
raffinés d’un univers féminin.
Les Adt ont profité de l’opportunité de la mode et des progrès de la
technologie pour fabriquer cette variété d’articles d’une esthétique recherchée
qui nous ravit encore aujourd’hui.
La matière plastique a menacé et remplacé la fabrication des objets
en papier mâché, sauf dans quelques pays comme la Russie, l’Inde, le
Viêt Nam où l’on continue à fabriquer des boîtes de façon artisanale,
dans cette matière bon marché décorée avec goût, héritage d’un savoir-
faire ancestral.
Histoire parallèle,
les ADT de Forbach
par Mélanie TAGLIARINI
http://www.sarreguemines.fr/asp.net/main.html/section.aspx?allid=39-60-272
Pierre Adt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Adt
http://www.un-forbachois.net/Site2004/Adt/Famille_ADT.html
http://forbach.com6-interactive.fr/admin/preview/retour_france.html
previous: Back
parents: Dictionnaire du département de la Moselle